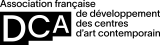Caroline Duchatelet

©Caroline Duchatelet
Assis face au noir. Dans le noir. C’est le noir des débuts. Patiente un peu. Ecoute ton cœur qui bourdonne. Pas de panique, il va finir par se calmer. Oublie-le. Tes pensées papillonnent dans ton cerveau. Laisse-les filer au loin comme la brise. Tu scrutes, tu écarquilles. N’y aurait-t-il pas un léger tremblement, là, à droite du cadre noir de l’écran, comme un début de quelque chose, qui sourd du fond indistinct, qui vibre ? Un trait qui devient une lueur. Tu t’y accroches, tu veux voir. Mais ce ne sont pas tes yeux qui voient. La faible clarté commence sensiblement à dessiner des formes encore noyées dans l’ombre. « Ça » émerge. Ta respiration se dénoue, tu cesses d’attendre. La lumière, imperceptible il y a encore quelques instants est manifeste, palpable maintenant. Elle pénètre dans un espace clos, un intérieur, le révèle, le caresse. Il n’y a que par elle qu’il t’est donné. C’est la lumière du jour qui progresse, entre par l’embrasure d’une fenêtre sur la droite. Mais tu es encore trop pressé. Un mur, un renfoncement, un sol… Ils ne se livrent pas si facilement, leurs contours sont mouvants, ils se proposent, se refusent, et c’est autre chose que tu remarques maintenant : la mosaïque noire et blanche d’un pavement, une profondeur qui accompagne ton regard vers ce qui se dessine au fond de la scène. Tu ne peux pas échapper aux nuances de couleur du premier plan qui s’imposent davantage mais tu divagues, tu erres d’un pan de mur à l’autre. Tu digresses. Cherches-tu à reconnaître quelque chose ? Un lieu autrefois visité, ou seulement rêvé ? D’où t’appelle cette vision ? Du lointain souvenir d’un tableau de Vermeer peut-être.
En quelques minutes, tu as senti dans toutes tes fibres, comme en état d’hypnose, à ton corps consentant, l’énergie du jour qui entre dans une pièce. L’aube d’avant l’aurore, d’avant le soleil, primitive. Au moment où la nuit s’ébroue, quand tout est encore possible. Tu savais qu’elle existait, il faut bien que le jour commence. Mais peut-être ne l’avais-tu jamais vraiment vue, éprouvée. Elle est profonde, intime. Son temps est organique, physiologique. Comme l’est celui du rêve qui ne dure souvent que quelques secondes, ne s’arrête pas sur une image fixe, achevée, et dont on sait qu’il est un intervalle avant une autre tranche de sommeil. Comme celui du nourrisson qui, dans le sein de sa mère, perçoit le monde en terme de rythme, d’intensité, et non en terme d’image. Cette lente apparition silencieuse résulte du façonnage du temps réel, celui qu’il faut à la lumière pour révéler un paysage, un lieu. C’est par un long travail de montage sur la durée, par d’imperceptibles ralentis, fondus et accélérés, sans jamais rien retrancher, que se révèlent à l’oeil les moments où quelque chose devient soudain perceptible dans le déroulé implacable de la montée du jour.
La captation de cette arrivée de l’aube par Caroline Duchatelet, à la fois lente et fugitive, relève du rituel : reconnaître un lieu. Choisir un cadre. Filmer longuement, du plus obscur noir immobile jusqu’au premier frisson, jusqu’à la première clarté de l’air, de l’espace. Recommencer. mercredi 4 novembre, dimanche 9 août, lundi 26 avril. Les titres des films de Caroline Duchatelet indiquent un jour et non un lieu, suggèrent une saison, ils sont précis sans narration, sans rien assigner. Ses errances lui appartiennent. D’abord habiter un paysage, accueillir une lumière dorée en Toscane comme le brouillard des petits matins de novembre en Meuse. Plutôt que des images, elle propose des moments, des expériences, aussi intimes qu’universelles. Ainsi, dit-on parait-il au Japon : « il y a de l’amour » plutôt que « je t’aime ».

©Caroline Duchatelet

©Caroline Duchatelet